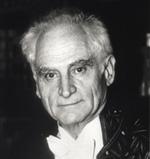Le verbe soudre est semblable à ces patriarches des temps anciens qui ont disparu, mais ont laissé une vaste descendance. On le trouve encore en moyen français, en particulier dans la Ballade des pendus, de François Villon :
« Prince Jhesus, qui sur tous a maistrie, / Garde qu’enfer n’ait de nous seigneurie : / A luy n’avons que faire ne que souldre. / Hommes, icy n’a point de mocquerie ; / Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre. »
Ce verbe est issu du latin solvere, qui signifie d’abord « détacher, délier », puis « payer, s’acquitter d’une dette », « désagréger, dissoudre » et, enfin, « résoudre, trouver la solution ». Les sens de solvere et de ses dérivés sont très variés ; ils le sont tellement que, pour en rendre compte, le français emploie deux formes de participe passé, l’un qui est emprunté du latin, l’autre qui vient directement du verbe français, et leurs sens diffèrent notablement. Ainsi on pourra dire que l’Assemblée est dissoute, sans que cela signifie qu’elle était dissolue, et que le souverain pouvait être absolu quand bien même il n’aurait pas été absout. Il en va parfois de même pour les noms puisque, à côté de l’absolution, existe l’absoute, un ensemble de prières dites par le prêtre au terme de la liturgie des défunts. De même, la soulte, « la somme qui, dans un partage, compense l’inégalité des lots », n’est pas la solution. Peut-être faut-il rappeler que le sens premier de solution est « séparation, rupture » et qu’une solution de continuité n’est pas, comme on le croit parfois et faussement, un moyen pour continuer quelque chose, mais l’interruption entre les parties d’un tout, auparavant continues. Cette expression apparaît au xive siècle dans le livre Chirurgie, d’Henri de Mondeville, le médecin de Philippe le Bel et de Louis le Hutin, et elle désigne une fracture dans laquelle les deux parties de l’os rompu ne sont plus en contact. Elle désignera, presque quatre siècles plus tard, sous la plume de Mme de Sévigné, une rupture entre deux personnes. Elle écrit dans une lettre du 14 juillet 1680 :
« Vous me demandez, ma Bonne, ce qui a fait cette solution de continuité entre La Fare et Mme de La Sablière. C’est la bassette ; l’eussiez-vous cru ? C’est sous ce nom que l’infidélité s’est déclarée ; c’est pour cette prostituée de bassette qu’il a quitté cette religieuse adoration. » (La bassette était un jeu de cartes fort en vogue à l’époque, où se jouaient de grosses sommes d’argent.)
La racine dont est tirée solvere est la même que celle que l’on trouve dans le gotique fraliusan, « perdre », un lointain ancêtre de l’anglais to lose, « perdre », mais aussi et surtout dans le grec luein, cher au cœur de tous les hellénistes, car c’est l’un des modèles qui servent à l’apprentissage des conjugaisons. Ce verbe a le même sens que le latin solvere et est à la base des formes françaises en -lyse ou en -lyte. On sait que l’analyse consiste à détacher les éléments d’un tout pour les identifier, que l’on effectue cette opération sur un corps chimique, sur une phrase ou sur une idée. Parmi les formes en -lyte, nous en retiendrons deux.
D’abord l’alyte. Sous cette dénomination savante se cache un mystérieux animal, plus connu sous le nom de « crapaud accoucheur ». Ces batraciens ont en effet une étrange particularité : le mâle conserve pendant six à huit semaines, en tresses autour de ses pattes arrière, les chapelets d’œufs pondus par la femelle. Il les gardera avec lui jusqu’à ce que, sentant l’éclosion proche, il s’installe dans une pièce d’eau où les petits pourront naître. Son nom alyte est emprunté du grec alutos, « qui ne peut être délié », parce que notre crapaud semble ne pouvoir être délivré de ces œufs avant que n’en sortent des têtards.
Ce suffixe se trouve aussi dans le nom Hippolyte. Ce nom, comme cela est très fréquent pour les patronymes grecs, a une signification. Avant d’être nom propre, le grec hippolutos est un adjectif qui signifie « qui détache les chevaux ». Ce sens fait particulièrement ressortir l’ironie cruelle de l’Hippolyte d’Euripide, puisque le héros meurt prisonnier des lanières qui entravaient ses chevaux et traîné par eux dans les rochers, et c’est bien parce que « celui qui détache les chevaux » ne les a justement pas détachés qu’il est mort. Les mots d’Euripide soulignent le retournement monstrueux qui est en jeu dans cet épisode, puisque si dans les derniers vers on entend le participe passé passif lutheis, « détaché, libéré », il ne qualifie pas les chevaux, mais Hippolyte lui-même.
Tout cela sera repris dans la Phèdre de Racine, mais notre langue ne marque plus ces rapprochements, et le dramaturge, faisant parler Théramène, emploiera d’autres verbes :
« Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes / […] / Dans les rênes lui-même il tombe embarrassé / […] / J’ai vu, Seigneur, j’ai vu votre malheureux fils / Traîné par les chevaux qu’il a nourris. »