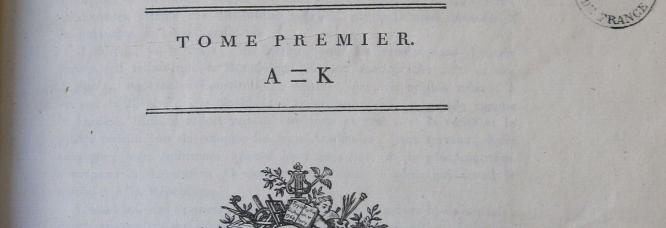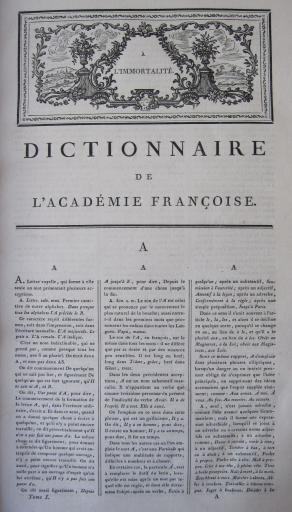DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
LA Révolution Françoise qui, dans sa marche, devoit rencontrer tous les obstacles, devoit aussi donner dans tous les excès. Les excès dont on doit le plus gémir et rougir, ont été des actes: mais ceux-là ont toujours été précédés par des excès dans les opinions.
Durant plusieurs années, tout ce qui n’est pas entré dans la Révolution comme instrument et comme acteur, a été regardé et traité comme contre-révolutionnaire.
Il y avoit trois Académies en France, l’une consacrée aux Sciences, l’autre, aux recherches sur l’Antiquité, la troisième, à la Langue Françoise, et au Goût. Toutes les trois ont été accusées d’aristocratie, et détruites comme des institutions royales, nécessairement dévouées à la puissance de leurs fondateurs.
Il falloit, je le crois, les détruire pour les recréer sous d’autres formes: il falloit que la République eût son Institut des Arts et des Sciences, né avec sa Constitution, destiné, par son origine même, à décorer la Liberté, à la fortifier, à la propager dans le monde comme la lumière. Mais il falloit surtout être juste et vrai; et la vérité et la justice ordonnoient de compter les trois Académies, leurs travaux, leurs ouvrages, leurs influences, parmi les causes qui ont le plus contribué à préparer la Révolution, à donner à la France le génie qui devoit la conduire à la République.
L’Académie des Sciences, toujours occupée de la nature et de ses lois, devoit nécessairement découvrir, dans les mêmes recherches, la nature de l’homme, ses droits et les lois de l’ordre social. L’exactitude rigoureuse de la Langue des Mathématiques, devenoit, pour toutes les Langues et pour toutes les connoissances humaines, un modèle qui apprenoit à éloigner de nous les erreurs, à rapprocher les vérités.
L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, fouillant toujours dans les ruines de l’Antiquité, devoit y trouver, partout, les monumens, les pensées, les lois, les sentimens de ces Républiques de la Grèce et de Rome, dont l’Histoire a été la plus éloquente protestation du genre humain contre toutes les espèces de tyrans et de tyrannies.
L’Académie Françoise ne sembloit appelée ni à de si grands objets, ni à de si hautes destinées: instituée, protégée par des Ministres, par des Rois, dont les éloges revenoient incessamment dans tous ses discours, on eût dit que l’unique et servile objet de sa fondation étoit l’art de cacher la bassesse de la flatterie sous les vains agrémens de la parole.
Entre les trois Académies, l’Académie Françoise, cependant, est celle qui a le plus contribué au changement de l’esprit monarchique en esprit républicain: en caressant les Rois, c’est elle qui a le plus ébranlé le trône: ce n’étoit pas le but qu’on lui avoit marqué, ni celui qu’elle avoit; c’est celui qu’elle a rempli; et cette influence a été l’effet nécessaire, quoique très-imprévu, de plusieurs circonstances de son institution.
Par un statut, ou par un usage, l’Académie Françoise étoit composée d’Hommes-de-Lettres, et de ce qu’on appeloit grands Seigneurs. Ses Membres, égaux comme Académiciens, se regardèrent bientôt égaux comme hommes: les futiles illustrations de la naissance, de la faveur, des décorations, s’évanouirent dans cette égalité académique; l’illustration réelle du talent sortit avec plus d’éclat et de solennité.
Cette espèce de démocratie littéraire étoit donc déjà, en petit, un exemple de la grande démocratie politique.
L’Académie Françoise, plus que les deux autres encore, donna un autre exemple très-contraire au régime monarchique, et qui devoit lui être très-fatal.
Les éloges publics prodigués aux Rois, n’étoient accordés qu’à eux: on eût dit que la louange, cette dette de la foiblesse, de l’admiration et de la reconnoissance, ne devoit jamais être payée par les Peuples qu’à la divinité et à la royauté. L’Académie Françoise, à leur réception et à leur mort, loua publiquement et solennellement ses Membres de tout ce qu’ils avoient écrit de vrai, de tout ce qu’ils avoient fait de bien; on entendit dans les mêmes pages, et souvent dans les mêmes lignes, l’éloge de Fénelon et de Racine à côté de celui de Louis XIV: les talens et les vertus loués, comme la puissance, commencèrent donc à être regardés comme des grandeurs: en rapprochant les titres on les comparoit; en les comparant, il étoit aisé de voir quels étoient les plus légitimes et les plus beaux.
L’Académie Françoise, dont les panégyriques ont été les sujets de tant de plaisanteries, ne les borne pas toujours à ses Fondateurs et à ses Membres; elle appela tout ce qu’il y avoit d’hommes éloquens dans la Nation à célébrer ses grands Hommes: le Magistrat qui avoit rendu la justice plus pure, les lois plus impartiales entre le puissant et le foible; le Guerrier qui avoit perfectionné l’art de rendre la victoire plus éclatante en la rendant moins sanglante, l’art de triompher par le génie plus que par la force; le Ministre qui à coté du trône, avoit travaillé pour la Nation, comme s’il avoit reçu sa mission d’elle; le Poète qui, au milieu des puissantes et douces émotions de la Scène, avoit fait servir les jouissances d’un grand Peuple aux progrès de sa raison et de sa morale; le Philosophe, dont le génie avoit cherché les lois de l’Univers, et trouvé quelques-unes des meilleures règles que l’esprit humain peut suivre dans ses recherches: tous ceux qui, dans tous les états et dans tous les genres, avoient servi avec éclat, avoient illustré et éclairé la Nation, reçurent ses hommages dans les séances publiques de l’Académie Françoise; ce qui n’eut d’abord l’air que d’un concours d’éloquence, devint un établissement vraiment politique et national: dans ces discours, dont plusieurs offriront éternellement des modèles à l’éloquence du patriotisme, tout prit le ton simple et auguste de la Langue républicaine; là, le nom de Roi étoit rarement prononcé; le nom odieux de Sujet, ne l’étoit jamais. Placés par les objets au milieu des plus grands intérêts de la Nation, les Orateurs ne voyoient qu’elle, ne parloient qu’à elle; et comme si, par un don de prophétie accordé aux sublimes inspirations des talens, ils voyoient déjà la République, en adressant la parole aux François, déjà ils les appeloient Citoyens.
Ces formes républicaines valurent à Thomas plus d’une persécution; mais elles naissoient, comme toute son éloquence, de l’élévation de son âme: et s’il étoit possible de le faire taire, il ne l’étoit pas de le faire parler autrement qu’en homme libre, qu’en Citoyen de ce Peuple si fécond en talens, et que tous les talens appeloient à la jouissance de ses droits, à l’exercice de sa souveraineté.
Richelieu, le vrai Fondateur de l’Académie Françoise, ne vouloit pas de maître pour lui-même; pour n’en pas avoir il le devint de son Roi. Il eut la fierté de l’orgueil; il ne pouvoit pas avoir celle de l’égalité et de la vertu. S’il avoit pu assister à l’une de ces solennités de l’Académie Françoise, sans doute il eût frémi de voir son ouvrage à ce point éloigné du but pour lequel il l’avoit créé: son but, cela est très-probable, n’avoit rien de politique; il n’étoit que littéraire.
Richelieu avoit la prétention de bien parler et de bien écrire: il institua l’Académie Françoise pour veiller à la pureté de la Langue, pour en faire le Dictionnaire: Richelieu ne songeoit à faire ni des Monarchistes, ni des Républicains; il songeoit à faire des Puristes; et cela prouve qu’il ne connoissoit pas plus ce que doit être un Dictionnaire, qu’il ne savoit ce qu’est une Nation.
Pour savoir ce que doit être un Dictionnaire, il eût fallu savoir ce que sont les Langues; et au siècle de Richelieu, parmi les Philosophes même de toute l’Europe, il n’y en avoit peut-être pas deux qui le soupçonnassent. Hobbes est celui qui paroît avoir le mieux connu, à cette époque, la nature des Langues et leurs rapports avec la nature de l’esprit humain.
A la naissance de l’Académie Françoise, on ne croyoit, en général, un Dictionnaire destiné et utile qu’à deux choses: quand on veut apprendre une Langue ancienne ou étrangère, à vous faire trouver, à côté l’un de l’autre, les mots équivalens ou correspondans de la Langue qu’on sait, et de la Langue qu’on étudie; et quand on veut acquérir la certitude de parler et d’écrire sa propre Langue avec pureté et élégance, à mettre sous vos yeux tous les mots de votre Langue en ordre alphabétique, avec la définition de leur valeur, de leur sens, avec des exemples de l’usage qu’on en fait dans les bons Livres et dans le beau monde.
Ce sont deux espèces de Dictionnaires.
La première espèce étoit à l’usage des Enfans et des Savans; la seconde servoit surtout aux Gens de Province, qui avoient l’ambition d’écrire et de parler comme à Paris, et aux Puristes de tous les Pays, pour terminer, par une autorité, leurs scrupules et leurs disputes sur l’usage des mots et des phrases de la Langue.
Depuis, les Langues ont été considérées sous des points de vue plus philosophiques; et les bons Dictionnaires, qui sont les archives des Langues, sont devenus des ouvrages plus difficiles et plus importans.
On a vu, depuis, que les mots ne nous servoient pas seulement, comme on le croyoit, à nous communiquer nos pensées, mais qu’ils nous étoient nécessaires pour penser; on en a conclu qu’il ne falloit pas s’occuper seulement des usages très-divers qu’on en faisoit, mais de l’usage constant qu’on en devoit faire: on en a conclu qu’il ne falloit pas consulter le beau langage du beau monde, comme une autorité qui décide ou tranche tout; parce que le beau monde pense et parle souvent très-mal; parce qu’il laisse périr les étymologies et les analogies; parce qu’il ferme les yeux aux sillons de lumière que tracent les mots dans leur passage du sens propre au sens figuré; parce qu’enfin la différence est extrême entre le beau langage formé des fantaisies du beau monde, qui sont très-bizarres, et le bon langage, composé des vrais rapports des mots et des idées, qui ne sont jamais arbitraires: on en a conclu encore que la vraie Langue d’un Peuple éclairé n’existe réellement que dans la bouche et dans les écrits de ce petit nombre de personnes qui pensent et parlent avec justesse; qui attachent constamment les mêmes idées aux mêmes mots, qui, guidés par un sentiment exquis, plus que par une érudition pénible, éclairent tous leurs discours de toute la lumière des étymologies, des analogies, et de ces figures du langage, de ces tropes, qui font sortir avec éclat tous les traits et tous les contours de la pensée.
En puisant dans ces sources, les Auteurs d’un Dictionnaire ne sont pas seulement utiles à ceux qui n’ont d’autre prétention que de parler et d’écrire purement et correctement une Langue; ils le sont à la Langue elle-même; ils le sont au bon sens et à la raison de tout un Peuple.
Ces deux assertions pourront surprendre, la dernière surtout. Elles sont pourtant d’une vérité assez simple, pour être rendues facilement évidentes, et en peu de mots.
Une Langue, comme l’esprit du Peuple qui la parle, est dans une mobilité continuelle: dans ce mouvement, qui ne peut jamais s’arrêter, elle perd des mots, elle en acquiert. Quelquefois ses pertes l’enrichissent, et ses acquisitions la défigurent: quelquefois ses pertes sont réellement des pertes, et ce qu’elle acquiert n’est pas une richesse: quelquefois elle se perfectionne également par les mots qu’elle adopte, et par les mots qu’elle rejette. Dans le premier cas, le bien et le mal se compensent; dans le second, il n’y a que du mal; dans le troisième, il n’y a que du bien. C’est cette troisième direction qu’il faut donner aux changemens d’une Langue, pour que tous ses changemens soient ou des progrès, ou des perfectionnemens; et cette direction constante, elle ne peut la recevoir que d’un Dictionnaire, fait suivant les vues et dans le plan dont nous avons parlé.
Un tel Dictionnaire, en effet, en même temps qu’il devient un dépôt de tous les mots de la Langue, en fait la revue. En déterminant les acceptions que l’usage le plus général leur a données, il prononce ou il indique le jugement qu’il faut porter de cet usage: il apprend à distinguer les cas où l’usage a eu raison, et les cas où il a eu tort. De tant de cas particuliers, où l’on voit la marche de l’usage, on ne tarde pas à remonter aux causes les plus générales qui tantôt ont égaré l’usage, et tantôt l’ont bien guidé. L’usage, qu’on a si souvent donné comme la seule Loi des Langues, verra donc lui-même les lois qui doivent le gouverner; il ne pourra pas les voir si distinctement sans les suivre; et tout un Peuple apprendra, dans un tel Dictionnaire, à fixer sa Langue sans la borner; à la fixer, dis-je, non dans des limites qu’on ne peut pas plus donner à la Langue d’un Peuple qu’à sa raison et à ses connoissances, mais dans les routes où elle pourra toujours s’avancer, en acquérant toujours de nouvelles richesses sans en perdre jamais aucune.
L’influence, bien plus importante, d’un bon Dictionnaire sur la raison d’un peuple, est, peut-être, plus facile encore à démontrer.
C’est une vérité universellement reconnue aujourd’hui; la cause la plus générale et la plus dangereuse de nos erreurs, de nos mauvais raisonnemens, est dans l’abus continuel que nous faisons des mots.
Cet abus lui-même a sa cause, et cette cause n’est pas simple; il y en a deux: la première est dans l’indétermination où chacun de nous laisse les mots en parlant et en écrivant; nous les prenons et nous les donnons tantôt dans un sens tantôt dans un autre: la seconde est dans le défaut d’une détermination universellement convenue et connue. Chaque homme qui parle et qui écrit, peut remédier à la première; et les grands Écrivains n’y manquent guère; ils se font une Langue qui est à eux; elle est exacte et claire dans les ouvrages philosophiques; elle est exacte, claire et belle dans les ouvrages d’imagination: ils parlent toujours cette même Langue qu’ils se sont faite: c’est pour cela qu’ils sont de grands Écrivains. Mais, par la raison, précisément, que chacun d’eux se fait une Langue, les Langues que tous se font sont différentes; et c’est à cette différence, qu’il faut attribuer très-souvent, celle des opinions qui les divisent: ils se croient séparés par des mondes; ils ne le sont souvent que par un mot dont ils ne font pas le même emploi.
Quand tous les grands Écrivains, par une espèce de traité secret et d’alliance très-naturelle entre le génie et le génie, s’accorderoient dans le même emploi des mots, ils sont en trop petit nombre; et leur convention, très-propre à en préparer de plus étendues, seroit loin encore d’être une convention rationale. C’est pourtant cet accord, c’est cette convention de tous avec tous, qui est indispensable, pour qu’un Peuple s’entende toujours dans la circulation de ses mots et de ses idées; pour que ce commerce de tous les esprits serve aux progrès et à la richesse de tous. Il faut que chaque mot d’une Langue, en quelque sorte, soit frappé d’une empreinte particulière, qui marque son titre et sa valeur, comme chaque pièce de la monnoie d’un Peuple: il faut qu’en donnant ou en recevant un mot, on sache ce qu’on reçoit et ce qu’on donne, comme en donnant un écu ou un louis.
Qu’est-ce qui peut donner à tous les mots d’une Langue cette empreinte, qui en fixe et qui en constate la valeur, non pour quelques Écrivains seulement, mais pour tous ceux qui parlent et qui écrivent dans cette Langue? Qui définira les mots pour toute une Nation, de manière que cette Nation sanctionne ces définitions en les adoptant, et ne s’en écarte point dans l’usage des mots?
Je réponds qu’un bon Dictionnaire peut, seul, donner à une Nation ces lois de la parole, plus importantes, peut-être, que les lois même de l’organisation sociale; et qu’un Dictionnaire, pour exercer cette espèce d’autorité législative, doit être fait par des hommes qui auront, à la fois, l’autorité des lumières auprès des esprits éclairés, et l’autorité de certaines distinctions littéraires auprès de la Nation entière.
Ces distinctions, les Membres de l’Académie Françoise les avoient reçues avec le titre même d’Académicien: et s’il falloit chercher des preuves de l’espèce de puissance littéraire que l’Académie Françoise a exercée sur la France, on en trouveroit dans les efforts même qu’on a toujours faits pour contester cette puissance, pour la nier ou pour la renverser: il faut être très-puissant pour faire le mal dont on l’a accusée, comme pour faire le bien dont on l’a louée.
Mais, cette autre autorité, l’autorité plus légitime des lumières, étoit-elle dans l’Académie et dans ses Membres?
Une réponse absolue est ici impossible: il faut distinguer les temps; et cette distinction, au lieu d’une réponse, qui n’eût été qu’à demi vraie, nous donnera deux réponses, entièrement vraies toutes les deux.
A sa naissance et long-temps après, l’Académie Françoise fut composée de trois espèces d’hommes, qui avoient assez peu de rapports les uns avec les autres, et qui, tous ensemble, n’en avoient pas beaucoup avec le travail d’un Dictionnaire.
C’étoient, en très-grand nombre, de beaux-esprits, comme Cotin, qui, n’ayant point de pensées, cherchoient des tours, et en trouvoient de ridicules; et un grand nombre d’Amateurs des Lettres plutôt que de Littérateurs, qui, n’écrivant point eux-mêmes, se constituoient lecteurs et juges de tout ce qu’on écrivoit, comme Conrard, et cinq à six hommes supérieurs, de ces génies éminens qui créent, pour leur Langue et pour leur Nation, les modèles de la Poésie et de l’Éloquence; comme les Corneille et les Bossuet.
De ces trois espèces d’Académiciens, les derniers, ces esprits créateurs, ont été, peut-être, ceux qui ont le moins travaillé au Dictionnaire, et qui y étoient les moins propres.
Dans leur sublime essor, occupés à enrichir les mots de nouvelles acceptions, ils ne pouvoient rabaisser leur génie à la recherche et à la définition des acceptions connues. Ils étoient trop doués de ces facultés exquises de l’imagination qui analyse par le sentiment et par le goût; et ils ne possédoient pas assez cette analyse de l’entendement qui veut remonter jusqu’aux principes même du sentiment, qui impatiente quelquefois le goût, alors même qu’elle l’éclaire.
Les beaux-esprits, ces singes maladroits du talent et du génie, aussi dépourvus du don de sentir que de l’art de définir, étoient trop occupés à défigurer et à gâter la Langue dans leurs sonnets et dans leurs sermons, pour travailler beaucoup à la fixer dans un Dictionnaire. Ils s’en mêloient peu; et c’est ce qu’ils faisoient de mieux pour cet ouvrage.
Tout le travail du Dictionnaire étoit donc presqu’entièrement abandonné à ces Amateurs des Lettres qui n’écrivoient rien, et qui prononçoient sur tous les écrits; qui, tout fiers d’être Académiciens, ne manquoient pas une séance et une discussion, se faisoient tour-à-tour, entre eux, Directeurs et Secrétaires de l’Académie, et croyoient diriger et faire la Langue comme ils faisoient et dirigeoient le Dictionnaire.
On voit qu’à cette époque, le Dictionnaire de l’Académie Françoise ne pouvoit pas être très-bon; il ne pouvoit pas non plus être très-mauvais: il fut médiocre; et c’est ce qu’il pouvoit être.
Pour le faire paroître plus mauvais, on en publia d’autres; et il en parut meilleur.
A sa naissance même et malgré toutes ses imperfections, le Dictionnaire de l’Académie Françoise fut une autorité dans la Nation et dans la Langue, parce que l’Académie elle-même en étoit une. La critique du Cid, si supérieure à toutes les critiques qui paroissoient dans le même temps, prouve que cette autorité n’étoit pas tout-à-fait usurpée.
Cependant, au milieu des progrès de la Poésie, de l’Éloquence et de tous les Beaux-Arts, l’esprit philosophique naissoit; il entroit à l’Académie Françoise caché, tantôt sous le nom d’un Orateur ou d’un Poète, tantôt sous celui d’un Grammairien et d’un homme de Goût: c’est cet esprit qui, seul, peut faire un bon Dictionnaire: il aime l’étude des mots, parce qu’il ne peut se passer de la justesse des idées ; et la variété, l’importance, la richesse des points de vue, sous lesquels il envisage cette étude qui, aux esprits frivoles, paroît puérile et sèche, la fait embrasser et cultiver avec une sorte de passion par tous les esprits pénétrans, étendus, solides. Les Académiciens, qui n’avoient vu d’abord qu’un devoir pénible dans le travail du Dictionnaire, y cherchèrent bientôt, pour leur esprit et pour leur goût, des plaisirs et des secours: les séances et les discussions se prolongèrent.
Chaque nouvelle Édition du Dictionnaire corrigea donc ce qu’il y avoit d’imparfait, et ajouta à ce qu’il y avoit de bon: la dernière fut celle de 1762.
A cette époque, déjà depuis vingt ans à-peu-près, l’Académie Françoise étoit composée très-différemment qu’à sa naissance et dans les jours qui la suivirent. Pascal, Bossuet, Racine, Boileau, n’avoient pas été surpassés, ni peut-être égalés; mais ils n’étoient que des Maîtres, et ils avoient formé des Écoles; les génies créateurs, les talens sublimes, n’étoient pas plus nombreux; le nombre étoit beaucoup plus grand des Écrivains qui se partagoient avec éclat tous les genres de Littérature et des esprits qui cultivoient avec succès tous les genres de connoissances.
L’esprit humain, qui avoit pu s’observer dans les Arts et dans les Sciences crées par lui, avoit appris à s’étudier en lui-même et dans ses chefs-d’oeuvre. De cette étude, étoit né cet esprit qu’on a appelé l’esprit philosophique. C’étoit dans l’observation des Langues, surtout, que cet esprit philosophique avoit pris sa naissance et ses lumières; et il reversoit surtout ses lumières sur les Langues où il les avoient puisées.
Il n’y avoit pas de Philosophe qui ne fût profond Grammairien, ni de Grammairien qui ne fût grand Philosophe. Les Locke étoient des Dumarsais; les Dumarsais étoient des Locke.
Une analyse hardie, fine et sûre, poursuivoit l’esprit dans ses plus secrètes opérations, le goût dans ses impressions les plus mystérieuses, et dévoiloit à l’un et à l’autre les prodiges de la pensée et du sentiment.
En préparant des siècles nouveaux, l’esprit philosophique avoit fait renaître les études, presque abandonnées, des beaux siècles de l’antiquité. Homère et Virgile, dont on avoit voulu ébranler les autels, recevoient un culte plus éclairé, un culte qui n’étoit plus celui de la superstition, mais celui d’une admiration sentie, et de l’amour.
Tous ces progrès de l’esprit humain entroient dans l’Académie Françoise avec les hommes auxquels la France et l’Europe en étoient redevables; et les hommes illustres qui n’en étoient pas, y faisoient entrer encore leurs lumières.
Là, les Poètes, les Orateurs, les Historiens, capables de rendre compte à chaque instant des règles et des principes de leur Art qu’ils avoient approfondis, étoient également capables d’analyser, avec finesse et justesse, tous les mots et tous les procédés de leur instrument de la Langue Françoise. A cette même époque, où les Écrivains distingués descendoient dans toutes les profondeurs de leur Art et de leur Langue, ils se répandoient davantage dans le monde: en y parlant leur Langue ils observoient celle qu’on y parloit: ils observoient l’usage dans ces sociétés brillantes de Paris et de la Cour, d’où il dictoit des lois à toute la France.
Tels ont été les hommes qui, depuis 1762, époque de la dernière Édition du Dictionnaire, jusqu’à la destruction de l’Académie, c’est-à-dire, pendant trente ans, ont travaillé constamment ensemble à l’Édition que nous donnons aujourd’hui à la France et à l’Europe.
On a nié que ce fût un avantage pour un Dictionnaire d’être composé par trente ou quarante Coopérateurs; on a prétendu qu’un Dictionnaire, comme tout autre ouvrage, ne peut être très-bon que lorsqu’il a été conçu et exécuté par un seul homme.
Nous n’examinerons point si les hommes qui, à différentes époques, depuis Furetière, ont fait de pareilles entreprises, y ont réussi: ceux qui annoncent aujourd’hui avec tant de bruit qu’ils font seuls un Dictionnaire de toute la Langue, paroissent croire, au moins, que la même confiance a beaucoup trompé ceux qui l’ont eue avant eux.
Nous examinons la chose en elle-même.
Il n’y a presque pas de mot dans une Langue qui ne soit pris dans une multitude d’acceptions différentes; d’analogie en analogie, un mot passe d’acceptions en acceptions; dans les Arts qui se ressemblent le plus il reçoit des acceptions très-variées; dans la bouche même de l’Orateur, de l’Historien et du Poète, déjà il a des nuances que le goût distingue beaucoup, quoiqu’elles soient légères; et les Arts les plus éloignés l’un de l’autre, des Métiers qui n’ont aucun rapport ensemble, s’en emparent: enfin, tous les Esprits, tous les Talens, tous les Arts, tous les Métiers, travaillent sur chaque mot d’une Langue, avec ce mot et autour de ce mot. Dans le même mot il y a mille expressions; et un Dictionnaire n’est bien fait, que lorsque ces mille expressions sont saisies et rassemblées autour du mot qui en est devenu le signe.
Est-ce un seul homme, étranger nécessairement à tant d’usages du même mot, qui les connoîtra tous? Et n’est-il pas plus raisonnable d’attendre cette connoissance de trente ou quarante hommes, dont les études, les travaux et les talens sont partagés entre tous ces Arts et toutes ces Sciences; qui ont rencontré cent fois toutes ces acceptions des mots dont l’origine commune, en s’effaçant de nuance en nuance, finit souvent par entièrement se perdre?
Quarante hommes, éclairés dans beaucoup de genres, peuvent être regardés, en quelque sorte, comme les Représentans d’une Nation, chargés par elle de recueillir et de sanctionner toutes les acceptions qu’elle donne à tous les mots. On ne peut pas supposer, que cette espèce de mission universelle soit donnée à un seul homme, toujours incapable de la remplir, par cela même qu’il est seul.
Cette vérité, évidente pour tout le monde, frappera bien davantage ceux qui ont assisté à des discussions entre plusieurs personnes sur les mots et sur les acceptions qu’ils reçoivent dans une même Langue.
Chacun de ceux qui ont parlé est tenté de croire qu’il a tout vu; à l’instant où un autre commence à discuter, chaque parole ouvre des points de vue qu’il eût été impossible à tous de soupçonner: à mesure que le nombre de ceux qui parlent s’augmente, les points de vue et les acceptions augmentent aussi, et dans une progression beaucoup plus grande; les idées que chacun entend lui en rappellent ou lui en font naître de nouvelles: ceux qui ont une mémoire lente et paresseuse, sont étonnés de l’activité qu’elle reçoit d’une mémoire plus prompte et plus étendue; des souvenirs effacés se réveillent; des exemples perdus se retrouvent; tous croyent apprendre pour la première fois la Langue que toute leur vie ils ont étudiée.
Si l’on réfléchit actuellement entre quels hommes de pareilles discussions ont eu lieu si long-temps au Louvre; et si l’on est juste; si l’envie et la haine ne poursuivent pas les Académiciens à travers les tombeaux des Académiciens, de l’Académie, et de la Monarchie; on avouera que ce Dictionnaire, qui est le résultat de ces discussions, doit être le seul, où la Nation Françoise et les Nations de l’Europe peuvent chercher avec confiance les usages et les lois de notre Langue.
Une autre circonstance unique en faveur de ce Dictionnaire, c’est que, commencé à l’époque précisément où la Langue Françoise commençoit elle-même les grands progrès qui devoient lui donner ses plus beaux caractères et sa perfection, il n’a jamais été interrompu un moment; il a assisté à tous ces progrès; il en a tenu note en y concourant; il a été un témoin et il est devenu un monument fidèle de toutes ces variations fugitives qui ne laissent aucuns souvenirs, si on ne les marque pas à l’instant même où ils se succèdent et passent; c’est qu’enfin il a été fini à l’instant où la Monarchie finissoit elle-même; et que par cela seul, il sera pour tous les Peuples et pour tous les Siècles la ligne ineffaçable qui tracera et constatera, dans la même Langue, les limites de la Langue Monarchique et de la Langue Républicaine.
Chez aucun autre Peuple et dans aucun autre Siècle, il n’a existé un pareil Dictionnaire: il ne peut plus en exister pour les Langues de l’Europe; elles n’ont pas reçu, sans doute, tous leurs accroissemens; mais elles ont reçu tous leurs caractères. Des Dictionnaires pourront bien dire où ces Langues sont arrivées: mais ils ne pourront plus les accompagner, en quelque sorte, dans le chemin qu’elles ont suivi; ils ne pourront pas les aider dans tous leurs accroissemens et dans leur formation.
Il étoit indispensable d’ajouter à ce Dictionnaire les mots que la Révolution et la République ont ajoutés à la Langue. C’est ce qu’on a fait dans un Appendice. On s’est adressé, pour ce nouveau travail, à des Hommes-de-Lettres, que l’Académie Françoise auroit reçus parmi ses Membres, et que la Révolution a comptés parmi ses partisans les plus éclairés. Ils ne veulent pas être nommés; leurs noms ne font rien à la chose; c’est leur travail qu’il faut juger; il est soumis au jugement de la France et de l’Europe.