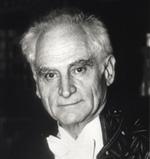 Communication dans la séance du jeudi 17 janvier 2013
Communication dans la séance du jeudi 17 janvier 2013
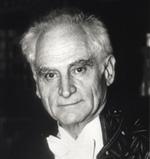
Bactérie, champignon, baleine ou séquoia, nous ne connaissons pas d’être vivant dont on ne puisse pas dire qu’il émet de l’information, qu’il reçoit de l’information, qu’il stocke de l’information et qu’il traite de l’information. Un tel constat semble si général dans le règne vivant qu’on serait tenté de définir la vie par ces quatre opérations. Ce n’est pourtant pas possible, tant surabondent les contre-exemples : en effet, qu’il s’agisse de particules, de cristaux, de mers, de continents, de planètes, d’étoiles ou de galaxies, on ne connaît pas d’objet inerte dont on ne puisse dire qu’il émet de l’information, qu’il reçoit de l’information, qu’il stocke de l’information et qu’il traite de l’information. Peut-on en conclure pour autant que ces quatre opérations caractérisent la totalité des objets de l’Univers ? Non, car, encore une fois, les contre-exemples abondent : ainsi, on ne connaît pas d’être humain ou de collectivité (ferme, village, métropole ou nation) dont on ne puisse pas dire qu’ils reçoivent de l’information, qu’ils émettent de l’information, qu’ils stockent de l’information et qu’ils traitent de l’information. Ces quatre fonctions paraissent donc universelles.
Mais il convient d’ajouter deux sortes de remarques. La première consiste à définir ce qui est appelé ici « information » : le mot est employé par M. Michel Serres non dans l’acception courante que lui donnent les médias (journaux, radios et télévisions), mais au sens de Léon Brillouin, père, avec Claude Shannon, de la « théorie de l’information », à la fin des années 1940. M. Michel Serres se propose de développer ce point si ses confrères lui en font la demande.
Cette notion étant établie, il est possible de définir ce qu’est un ordinateur : c’est une machine qui émet de l’information, qui reçoit de l’information, qui stocke de l’information et qui traite de l’information. C’est par conséquent une machine universelle, et elle est nouvelle en ce que, précisément, elle mime tous les objets dont on vient de parler, sans exception. Une fois que l’on a montré que l’ordinateur remplissait ces quatre fonctions, on n’a pas pour autant expliqué comment on le fabrique, ni surtout à partir de quoi il est fabriqué. Un ordinateur est construit à partir d’éléments matériels (verre, métaux, en particulier des métaux rares, comme le silicium) et de programmes, qu’on fait entrer dans ces éléments matériels. Les Anglo-Saxons parlent de hard(ware) pour désigner les matériaux eux-mêmes, et de soft(ware) pour parler des programmes et des mémoires, c’est-à-dire des messages, qui sont intégrés dans ceux-ci. M. Michel Serres rappelle dans quelles conditions le mot « ordinateur » a été proposé dans les années 1950 pour traduire l’anglais computer, par un latiniste spécialiste de théologie médiévale, au cours d’une discussion avec des élèves scientifiques au « pot » de l’École normale supérieure (ce terme est en effet tiré de l’expression du latin tardif Deus ordinator). La supériorité évidente du français par rapport à l’anglais (l’ordinateur n’est pas un « compteur ») explique le succès de ce terme, qui s’est rapidement implanté dans l’usage. Pour revenir à ce qui constitue l’ordinateur lui-même, on peut donc le définir comme un couple associant un support à un message.
M. Michel Serres va s’attacher à mettre en lumière les conséquences qu’entraîne l’apparition de l’ordinateur sur le temps, l’espace, la connaissance et, en particulier, les conduites humaines.
Il convient tout d’abord de considérer le couple formé par un support et un message dans une perspective historique. Il y eut un temps où les échanges entre les hommes étaient seulement oraux : le corps humain constituait le support matériel du message transmis par la parole (c’est-à-dire un train d’ondes sonores). Le premier stade dans l’histoire du couple support-message correspond bien à cette ère de l’oralité. Un premier bouleversement intervient avec l’apparition de l’écriture, en Chine et dans le Croissant fertile – à peu près à la même époque. L’écriture constitue le second avatar du couple support-message. Il consiste en une externalisation du support matériel (non plus le corps humain, mais du bronze, de l’acier, des peaux de veau – le vélin –, puis de mouton – le parchemin –, le byblos et enfin le papier). Le couple corps-ondes aériennes est ainsi remplacé par le couple matière-inscriptions, que celles-ci soient alphabétiques ou signalétiques. Il est nécessaire de s’arrêter sur les transformations que cette première révolution a entraînées : l’instauration du droit (le premier texte juridique connu est le code d’Hammourabi), la naissance de la politique, avec la création d’un corps de scribes et la centralisation de l’État, l’essor des villes, l’apparition de la monnaie (matérialisation du couple support-message, qui a libéré les échanges et permis le développement du commerce), et, dans la sphère grecque, l’invention des sciences (en Grèce, les mathématiques sont étroitement liées à l’écriture) et de la paidéia (l’existence d’un corpus écrit des poèmes homériques a rendu possible l’existence d’une paidéia stable), et, dans la sphère hébraïque, l’institution, avec le monothéisme, d’une « religion du Livre (l’“Écriture sainte”) » par les prophètes écrivains d’Israël. Peut-on dire pour autant que la naissance de l’histoire procède de l’apparition de l’écriture ? Une telle assertion amène à rejeter hors de la civilisation tous les peuples qui ne connaissent pas l’écriture. Or, de nos jours encore, les langues non écrites sont beaucoup plus nombreuses que celles qui possèdent un système graphique. Une des formes du racisme consistait précisément à considérer comme « préhistoriques » des hommes qui étaient pourtant nos contemporains. La définition de l’histoire à partir de l’invention de l’écriture doit donc être rejetée et considérée comme très dommageable du point de vue moral. Il convient seulement de bien mesurer le spectre de l’évolution entraînée par l’apparition de l’écriture. Les historiens ont tendance à privilégier les modifications affectant le support, sans voir que les grands bouleversements correspondent en réalité aux différents avatars du couple support-message.
Or un nouveau changement dans ce couple support-message intervient au xve siècle avec l’invention de l’imprimerie par Gutenberg. Dans ce cas également, les conséquences sont immenses, tant sur le plan religieux et politique (la Réforme, qui considère que « tout homme est pape, une bible à la main », coïncide avec l’invention de la démocratie moderne), économique et financier (naissance à Venise de la comptabilité, apparition de nouveaux moyens de paiement, comme le chèque, mise en place de nouvelles pratiques financières, avec la création de grandes compagnies bancaires) que sur le plan scientifique (la science expérimentale constitue la deuxième révolution après l’invention des mathématiques en Grèce). On peut observer que le spectre des transformations induites par le second avatar du couple support-message est strictement le même que le précédent.
Avec l’ordinateur, on parvient à un quatrième avatar du couple support-message : après le passage du support écrit au support imprimé, cette nouvelle révolution technologique est caractérisée par l’apparition du support numérique. Or le spectre de ce nouveau bouleversement est identique à celui des deux mutations précédentes : c’est pour cette raison que s’observe aujourd’hui une crise profonde dans le domaine politique, économique et financier, culturel, éducatif et religieux. L’ordinateur est en effet une machine nouvelle qu’il convient d’interpréter à la lumière d’une histoire très ancienne, et qui n’est que le dernier avatar des modifications successives du couple support-message.
Si les crises dont on vient de parler ont incontestablement entraîné une transformation du temps, il faut observer que celle-ci s’est doublée d’une transformation de l’espace. M. Michel Serres a appelé « Petite Poucette » l’héroïne qui incarne ces transformations. Celle-ci a une devise, qui donne le sens d’un adverbe de temps : maintenant. Cet adverbe ne renvoie pas aux choses présentes, qui s’étalent sous nos yeux, mais signifie bien plutôt, d’après son étymologie : « tenant en main ». Cette devise est la suivante : « Maintenant, tenant en main le monde » (avec un ordinateur portable, une tablette et un téléphone mobile). Comment faut-il entendre cette devise ? Avec le GPS (Global Positionning System), tous les lieux sont en quelque sorte réunis dans la main de « Petite Poucette » : ils peuvent en effet être immédiatement repérés, et même visualisés, grâce à des fonctions telles que Google Earth ; toutes les informations existant au monde sur un sujet donné peuvent également être réunies au moyen de moteurs de recherche ou de services sur l’internet tels que Wikipédia ; « Petite Poucette » peut enfin joindre avec son téléphone mobile n’importe qui à n’importe quel endroit du monde. Le nombre d’appels téléphoniques pour qu’un individu quelconque parvienne à entrer en communication avec un autre en quelque lieu que ce soit et quelle que soit la distance qui les sépare se limite aujourd’hui à 4,3 (il était de 7,6 il y a quelques années encore), grâce en particulier à la généralisation de l’internet et surtout au développement des réseaux sociaux, qui regroupent plusieurs dizaines d’individus. Les mathématiciens parlent de « théorème du petit monde » pour rendre compte de cette évolution. Les modifications qu’a connues la notion d’« adresse » donnent la mesure d’un tel phénomène. Les chiffres de l’adresse postale (numéro de la voie, code postal, indicatifs internationaux) codent un lieu précis et déterminé, qui correspond à une mesure de l’espace – espace qu’on peut appeler « euclidien », ou, mieux, « cartésien », car il se réfère à des coordonnées cartésiennes (abscisses et ordonnées) – ; les géomètres parlent pour leur part d’« espace métrique », pour indiquer qu’il est fondé sur la mesure des distances. Mais la véritable adresse n’est plus aujourd’hui l’adresse postale : c’est à partir de l’ordinateur, de la tablette ou du téléphone mobile qu’ont lieu de nos jours la plus grande partie des échanges, ainsi donc l’adresse électronique (l’« adel », comme disent les Québécois) ou le numéro de téléphone mobile sont devenus prépondérants. Or ils induisent une abolition de l’espace métrique, fondé sur la mesure des distances : ils s’en affranchissent, puisque n’importe qui peut atteindre n’importe qui n’importe où et correspondre de cette manière avec lui. Le code de cette nouvelle forme d’adresse ne dépend plus en aucune manière de la mesure des distances. Nous n’habitons plus le même espace : nous sommes réunis dans un espace mondial de « voisinage » – tous les hommes sont devenus nos « prochains ». L’« ancienne » adresse désignait le lieu de l’espace, identifiable et repérable, géométriquement circonscrit, où le pouvoir politique pouvait m’assigner, me surveiller et, le cas échéant, m’appréhender. La « nouvelle adresse » ne correspond à aucun point assignable de l’espace, puisque je l’emporte avec moi où que je me trouve – elle ne renvoie plus ainsi à aucun lieu déterminé. L’ordinateur n’a pas seulement raccourci les distances, il les a abolies ou, mieux, annulées. Dès lors que l’humanité n’habite plus le même espace – qu’elle « n’a plus la même adresse » –, elle ne se réfère plus aux mêmes institutions, d’où la crise que nous traversons actuellement, dans tous les domaines du savoir et de la vie sociale. Les institutions sont en effet fondées sur des analyses fines des concentrations et des distributions dans l’espace. L’abolition de l’espace revient à les frapper brutalement de désuétude. Toutes nos institutions renvoient à un aménagement de l’espace qui s’est trouvé frappé de nullité par l’ordinateur, qui a non seulement réduit les distances (c’est ce qu’ont fait tous les grands moyens de transport), mais l’a bel et bien aboli. Le remplacement des grandes bibliothèques traditionnelles – concentrations en un lieu unique de tous les savoirs – par les banques de données accessibles sur l’internet illustre de façon exemplaire l’ampleur de ce changement, chaque ordinateur individuel pouvant contenir l’équivalent de plusieurs bibliothèques. À l’évidence, les conséquences de cette mutation sur l’acquisition du savoir, l’enseignement et la pédagogie sont immenses.
Revenons un moment à l’ordinateur : c’est une machine qui stocke une quantité de plus en plus importante d’informations. Cette capacité de stockage s’appelle précisément une « mémoire » (des térabits gravés sur le silicium du processeur dont est constitué le « disque dur »). On parle effectivement de « mémoire », bien que la mémoire humaine n’ait aucune proportion avec les quantités d’informations qui peuvent être contenues dans les circuits intégrés d’un ordinateur individuel. Celui-ci peut par ailleurs stocker des milliers d’images, en si grand nombre qu’il faudrait à l’imagination humaine plusieurs milliers d’années pour pouvoir les réunir. L’ordinateur est donc une machine douée de mémoire et d’imagination, sans commune proportion avec les facultés humaines ; elle possède aussi, grâce à des logiciels et à des moteurs de recherche, la capacité de résoudre des problèmes, d’effectuer des opérations si complexes qu’elles échappent à la raison humaine (l’ordinateur intègre par exemple des équations différentielles). L’ordinateur est ainsi doué d’une véritable capacité rationnelle. La philosophie définissait traditionnellement la connaissance comme l’exercice de ces trois facultés que sont la mémoire, l’imagination et la raison. Or ces facultés, qui organisaient la connaissance humaine, sont les composantes de cette étrange machine qu’est l’ordinateur. L’ordinateur posé devant moi, sur ma table de travail, est en quelque sorte l’externalisation de ma propre cognition. Il ne s’agit plus cette fois d’une modification qui affecte seulement le temps ou l’espace, mais bien l’« ego cogito » lui-même. Cette « révolution » est d’ordre philosophique, puisqu’elle consiste en l’externalisation pure et simple du processus cognitif individuel. Que reste-t-il alors à « Petite Poucette », dépossédée pour ainsi dire de ses facultés intellectuelles au profit de l’ordinateur, « décapitée », en quelque sorte, à l’image du saint Denis de l’iconographie chrétienne, dans la mesure où elle contemple devant elle le processus cognitif qui la caractérise en tant qu’« ego cogito », matérialisé et externalisé dans les circuits intégrés de son ordinateur ? Que reste-t-il à l’homme, au terme de ce quatrième avatar de l’externalisation, qui entraîne la révolution la plus importante ? Ce halo de lumière dont les représentations de l’hagiographie chrétienne ornent le col de saint Denis : ce qui est le plus humain dans l’homme, à savoir l’invention, l’innovation – en un mot, l’intelligence.
On pourrait dire ainsi, au terme de cet exposé, que nous sommes en quelque sorte condamnés par cette révolution numérique à devenir intelligents.
Michel Serres
de l’Académie française

